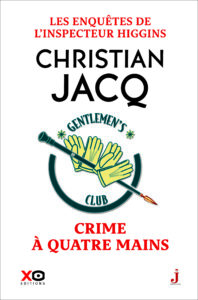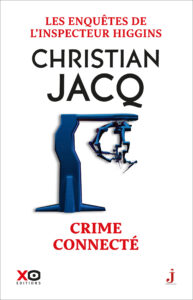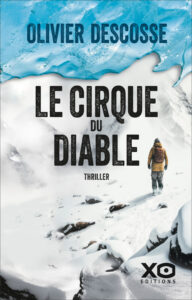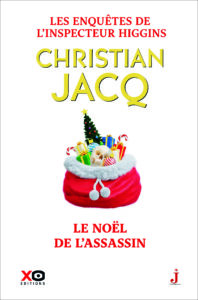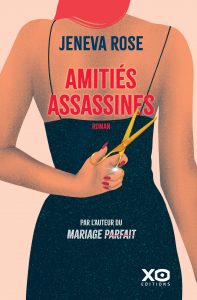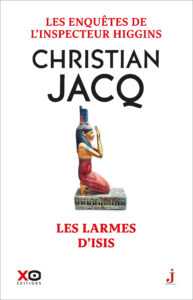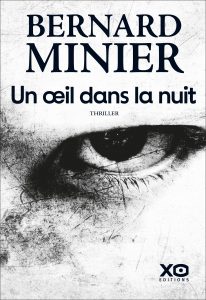Dans le cinéma et le théâtre, oui. Mon père était à l’époque une des stars de la Russie et faisait rêver les femmes avec ses rôles de jeune premier, l’équivalent de votre Jean Marais si vous voulez. Ma mère, elle, était comédienne et réalisatrice. Je suis né à Saint-Pétersbourg. À partir de douze ans, j’ai vécu à Moscou, dans un des plus beaux immeubles de la ville, gardé jour et nuit par le KGB parce que l’État avait entreposé du platine dans les caves. C’était très fréquent, une partie des réserves d’or, de métaux précieux étaient dispersées dans les immeubles du centre de Moscou.
Vous avez quitté la Russie à l’adolescence. Pourquoi vos parents ont-ils voulu partir ?
Par leur rêve de liberté idéalisée, leur passion du cinéma et par naïveté à la fois. Un des amis de mon père, émigré en Israël, lui a écrit en l’assurant qu’on n’attendait que lui, qu’il aurait des budgets et des rôles à profusion, et la liberté d’expression… Mes parents ont donc décidé de tenter l’aventure. Leurs problèmes avec le régime soviétique avaient commencé en 1965. Mes parents avaient travaillé ensemble sur un Roméo et Juliette qui a été interdit par la censure, parce qu’il risquait de « démoraliser la jeunesse ». Ensuite, personne ne voulait engager mon père au cinéma ni au théâtre. Mes parents se sont donc tournés vers un nouveau média, la télévision. Ils ont été les premiers, à Leningrad, à développer le concept du cinéma pour la télévision. Ils ont écrit et réalisé plusieurs films devenus de grands succès populaires. Alors mon père a été nommé responsable du cinéma à la télévision soviétique. Le poste, très important, imposait qu’il adhère au parti communiste. Son refus lui a valu beaucoup d’ennuis.
Mais vous avez eu du mal à obtenir l’autorisation de quitter le pays ?
Oui. Il faut se rappeler ce qu’était l’Union soviétique en 1972, un pays complètement fermé, où l’on n’entrait et ne sortait qu’avec de multiples autorisations. Une fois sa décision prise, mon père est allé demander un visa de sortie au KGB. Bien entendu, on le lui a refusé : « Quoi, une de nos vedettes nationales émigrer ! Ce serait mauvais pour le moral du peuple ! ». Il a compris qu’on ne l’autoriserait jamais à partir. Quelque temps après, notre voisin de palier, dans le fameux immeuble au platine, a demandé à lui parler. C’était l’entraîneur du club de football de Moscou. Il avait appris que nous voulions partir, et il proposait de nous aider. Il « connaissait quelqu’un qui connaissait quelqu’un… » au KGB, capable d’apposer les bons tampons sur nos papiers. En échange, il voulait que nous soyons partis avant quatre jours. Quand mon père lui a demandé pourquoi il nous aidait comme ça, il lui a expliqué qu’il mariait sa fille le dimanche suivant, et qu’il voulait récupérer notre appartement pour le lui offrir comme cadeau de mariage ! Alors nous sommes partis, en laissant presque tout sur place.
Vous n’êtes pas restés longtemps en Israël, assez vite vous êtes repartis vers l’Allemagne…
Nous sommes restés un an. La vie à Jérusalem n’était pas possible pour mes parents. Ils ne trouvaient pas de travail. Ils sont donc partis en chercher en Europe, et m’ont inscrit en internat dans la plus vieille école d’Israël, destinée aux plus pauvres. C’était en fait une sorte de gigantesque lupanar. J’ai fini par la quitter sans la permission de mes parents. Ensuite ils ont été embauchés par Radio Liberté, la radio financée par le Sénat américain pour diffuser des programmes qui combattaient l’influence du communisme. Elle était implantée en Allemagne, à Munich. C’est ainsi que je me suis retrouvé à l’école sur une base militaire américaine, où je me battais tous les jours parce que j’étais un « bâtard russe communiste »… Un mauvais souvenir !
Ensuite vous avez vécu six ans en Angleterre, où vous avez passé le bac et étudié l’histoire à l’université de Londres, et puis vous avez décidé de partir aux États-Unis et d’y devenir comédien. Qu’est-ce qui vous y a poussé ?
Le dernier trimestre de ma première année d’université, je l’ai passé à faire la fête à Paris. Le prétexte était la promesse faite à ma mère d’étudier la langue française. Je m’étais inscrit à l’Alliance française où je suis allé trois fois ! Bref, j’avais dix-neuf ans, je me suis amusé. Et puis un jour, au cinéma Odéon, j’ai vu The Turning Point de Herbert Ross. Shirley MacLaine y jouait une femme qui avait sacrifié sa carrière de danseuse à sa famille, alors que son amie d’enfance, Anne Bancroft, était désormais danseuse étoile. Elles se retrouvaient, et Shirley MacLaine disait à son amie qu’elle « aurait pu devenir » danseuse étoile, elle aussi, si elle ne s’était pas consacrée à ses enfants. Cette idée que je me retrouverais un jour à me demander ce que « j’aurais pu devenir » m’a paniqué. J’ai décidé de suivre mon désir d’enfance et d’être un comédien comme mes parents, mes grands-parents… Ou au moins de savoir si c’était possible. Et je suis parti aux États-Unis.
Et là, vous avez suivi les cours de Lee Strasberg ?
Oui, j’ai commencé par m’inscrire au Lee Strasberg Institute, et assez vite j’ai été choisi pour la classe professionnelle de Lee. C’est quelqu’un d’important dans ma vie. Je suis resté son élève jusqu’à sa mort, le 18 février 1982, où j’ai quitté l’école. J’ai alors voulu monter et jouer Cyrano de Bergerac. C’était une grande aventure, j’ai réuni péniblement l’argent nécessaire, j’ai « embauché » mes parents. Quand enfin nous avons joué la pièce, j’ai découvert l’extase de la scène, cette espèce de toute-puissance qui vous envahit. Une expérience extraordinaire, d’autant que la pièce a eu du succès, de bonnes critiques.
Vous avez exercé beaucoup d’autres métiers, jusqu’au jour où vous avez décidé de vous consacrer à l’écriture. Est-ce une passion qui remonte loin ?
D’abord, la littérature me passionne depuis toujours. J’ai tapé mes premières œuvres sur la machine à écrire de mon père, à sept ans. Mais à cause de mon parcours, j’ai parfois eu de drôles de préjugés. Je me rappelle avoir expliqué à mon professeur de littérature au lycée, en Angleterre, que Shakespeare finalement ce n’était pas si terrible, et que la traduction d’Hamlet par Pasternak était bien meilleure que l’original… Il était resté très calme, et m’avait offert le lendemain un dictionnaire d’anglais ancien. Après quelques mois de traduction mot à mot d’Hamlet, j’ai compris mon ignorance… Quant à l’écriture, c’est une expérience que je voulais tenter depuis longtemps. J’avais déjà essayé à la fin des années 80, quand je vivais aux États-Unis, mais je n’étais pas prêt. C’est en revenant en France, en 1995, que je me suis lancé. Depuis, je ne me suis plus arrêté, j’ai réécrit plusieurs fois La Sibérienne, et après avoir signé avec XO, j’ai écrit un deuxième roman. Je suis actuellement en train de travailler sur le troisième.
D’où vous est venue l’idée d’intégrer de « vrais » personnages dans votre roman, Gorbatchev ou Chevarnadze par exemple ?
Il est vrai que le procédé est plus répandu aux États-Unis qu’en France, mais pour moi c’était naturel. Je racontais une histoire avec des enjeux de pouvoir, je devais donc forcément faire entrer dans le jeu les personnages historiques du pouvoir à cette époque. Sur Gorbatchev, j’ai recueilli ce que me disaient les gens qui travaillaient avec lui au Kremlin. Son surnom, « Mâchoires d’acier », par exemple. Personnellement, je ne l’ai rencontré que beaucoup plus tard, il était redevenu un citoyen comme les autres. Il m’a paru sympathique.
Comment avez-vous acquis cette connaissance de la mafia russe ?
Je l’ai vraiment découverte en revenant en Russie, en 1990. Je venais d’être embauché par une société allemande de mode pour m’occuper de ses relations publiques en Russie. Depuis dix-huit ans que j’étais parti, tout avait changé et dans le même temps tout restait la Russie que je connaissais, qui coulait dans mes veines. La libéralisation avait été beaucoup plus vite que les lois, les règles étaient dictées par les situations, la loi ne pouvait pas suivre. Que la Russie soit corrompue n’était un mystère pour personne, mais cette corruption avait contaminé absolument tous les niveaux de la société. Pour travailler, on rencontrait soit l’ancienne nomenklatura, soit les mafieux. Dans ce genre de situation vous ne décidez pas grand-chose : quelqu’un vient vous trouver et vous dit « voilà, tu vas travailler avec untel et untel ». Et le plus étonnant, c’est que le système fonctionnait !
Vous avez donc travaillé avec des mafieux ?
Le problème ne se posait pas comme ça : entre 1991 et 1995, tous ceux que je rencontrais professionnellement avaient de l’argent, vraiment beaucoup. D’où venait cet argent était une question que l’on ne posait pas. Personne. Et si par hasard vous étiez assez têtu pour la poser, ce que j’ai fait, pour demander quel était le passé de ces gens qu’on vous faisait rencontrer, la réponse était plus que floue. On ne savait jamais vraiment avec qui on travaillait. Finalement, et ça a été un grand choc pour moi, les contacts les plus stables et les plus fiables étaient les anciens fonctionnaires du KGB. Les anciens de cette organisation que je détestais et redoutais quand j’étais parti, adolescent…
Mais vous a-t-on proposé d’intégrer le système ?
J’ai eu à plusieurs reprises des propositions de proches du pouvoir. Elles m’auraient rendu riche, à condition d’accepter de faire des choses amorales et criminelles selon ma conception occidentale de la loi et de la morale. Et tout ça sans poser de questions. J’ai refusé.
Votre héros, Jim, se retrouve une ou deux fois dans une situation périlleuse du fait de ses activités. Vous êtes-vous senti en danger en travaillant là-bas ?
Professionnellement, une seule fois. L’affaire s’est réglée grâce à un coup de chance inouï. J’avais sympathisé avec un proche conseiller de Eltsine. Un soir il m’a donné une carte en me disant : « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle ce numéro, demande telle personne, on t’aidera. » C’était le numéro central de la sécurité du Kremlin. En Russie, tout le monde ou presque sait reconnaître ces numéros de téléphone à quatre chiffres, qui donnent accès aux services centraux du Kremlin.
Quelque temps après, un de mes interlocuteurs imposés, propriétaire d’une agence de mannequins, un authentique mafieux celui-là, a commencé à faire pression sur moi, un véritable chantage, de manière réellement inconfortable. Ma première chance est qu’il se targuait d’être occidental, et de rester civil. à la fin d’un rendez-vous, je lui ai dit « Écoutez, je ne suis plus vraiment d’ici, je me rends bien compte que je ne suis pas qualifié pour discuter certains aspects de cette affaire… Je vous propose, pour régler toutes ces questions, ou si vous avez d’autres demandes, de prendre contact directement avec des gens plus compétents que moi. » J’ai sorti de ma poche la carte donnée par cet ami, et je l’ai fait glisser vers mon interlocuteur. Il a regardé la carte attentivement, le numéro à quatre chiffres, il a dit quelque chose comme « Ah oui, je vois », et je n’ai plus jamais entendu parler de lui. Voilà. C’était comme ça en Russie. Tout était rapport de force.