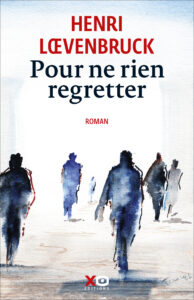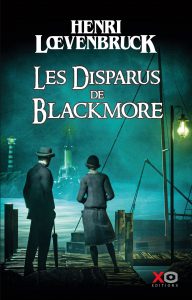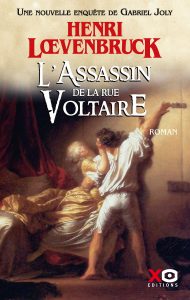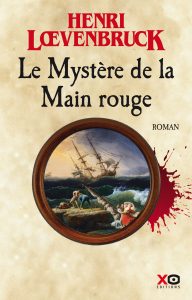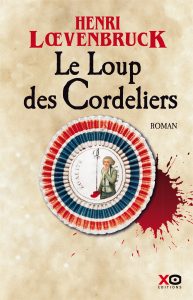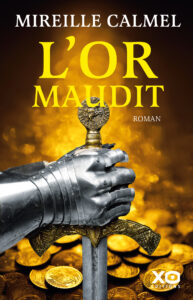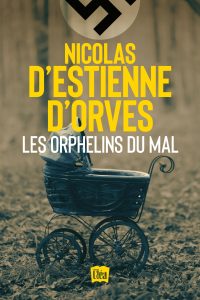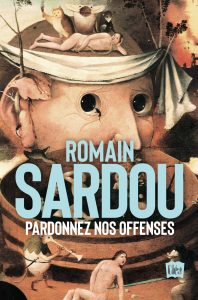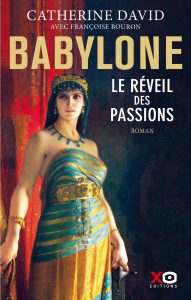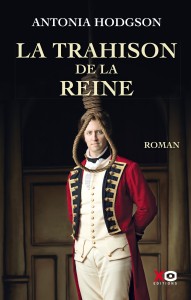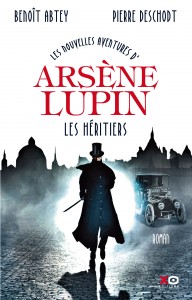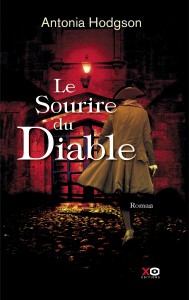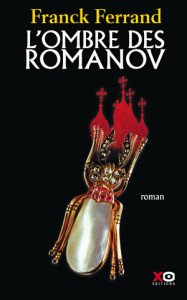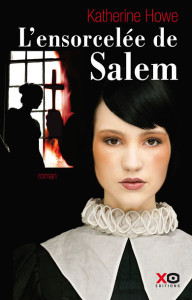Interview de l’auteur
Le Fantôme de Versailles clôt une quadrilogie autour de votre jeune journaliste d’investigation, Gabriel Joly. Un héros qui a conquis le cœur de centaines de milliers de lecteurs. Qu’est-ce qui vous attache à ce personnage et à quoi est-il confronté dans ce nouveau roman ?
Gabriel est, à sa manière, un précurseur du journalisme d’investigation, qu’il appelle « journalisme d’enquête ». Ce choix me permet, roman après roman, de le plonger dans de véritables investigations, quasi policières, tout en interrogeant son métier : sa méthode, son éthique et cet attachement têtu à la vérité, à une époque où, comme aujourd’hui, elle est mise à mal. Cette soif de vérité et de justice me rend évidemment Gabriel sympathique, tout comme la passion de sa jeunesse. Dans ce quatrième et dernier volet, il se retrouve au cœur des journées des 5 et 6 octobre 1789, lorsque les Parisiennes marchent sur Versailles pour réclamer du pain et contraindre le roi à venir à Paris. C’est un moment fascinant et décisif de la Révolution : les femmes y font entendre leurs voix alors même qu’elles sont exclues des bancs de l’Assemblée. Et, fidèle à l’esprit de la saga, j’entremêle l’Histoire et l’intrigue policière : de mystérieux meurtres éclatent jusque dans les murs du château de Versailles.
Ce livre est aussi l’occasion de vous attarder sur les figures de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Votre regard, pour l’un et pour l’autre, est plutôt bienveillant. Pourquoi cette compassion et sur quels récits historiques vous appuyez-vous pour faire ces portraits ?
Mon regard sur Louis XVI et Marie-Antoinette n’est ni à charge ni à décharge ; je le veux aussi objectif que possible. En m’appuyant à la fois sur les chroniques de l’époque et sur des travaux récents, j’ai cherché à montrer l’insouciance parfois désolante de Marie-Antoinette, mais aussi ses fragilités : le deuil d’un enfant, une mélancolie tenace. Quant à Louis XVI, souvent présenté comme un homme qui n’aspirait pas à régner, il porte le poids d’un destin écrasant. Pourtant – et Gabriel le lui dit dans une scène fictive – Louis n’est pas seulement une victime : il a pleinement profité des avantages de sa fonction et s’est à maintes reprises employé à freiner les réformes que le pays réclamait. Comme toujours, il serait réducteur de voir l’histoire comme un combat entre le bien et le mal. La Révolution était nécessaire, après des siècles d’injustices ; elle aurait pourtant pu suivre une voie moins tragique. La responsabilité de ses dérives incombe à la fois à certains révolutionnaires et à la famille royale.
Dans vos romans, vous mêlez l’Histoire, la grande, à des énigmes surprenantes où surgissent parfois des loups, des personnages masqués, et, comme ici, des ombres inquiétantes. D’où vous vient cette envie et quelles sont vos inspirations littéraires ou cinématographiques en la matière ?
La série des Gabriel Joly est un hommage assumé au roman populaire de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, ce grand art du feuilleton qui marie le plaisir du récit, la vitesse, l’émotion et le sens du spectacle. J’aime cette littérature parce qu’elle accueille le lecteur: elle n’exclut personne, elle promet l’évasion sans renoncer à l’Histoire, elle fait naître des personnages plus grands que nature et des intrigues pleines de rebondissements. De Dumas à Paul Féval, en passant par Eugène Sue, Ponson du Terrail, Michel Zévaco, Maurice Leblanc et Gaston Leroux, cette tradition a su mêler panache, mystère, humour et critique sociale, et j’ai voulu rendre hommage à ces auteurs qui ont bercé mon adolescence. La littérature populaire, quand elle est bien faite, sait instruire sans peser, divertir, émouvoir, et donner au lecteur l’ivresse d’« une page de plus ». Avec Gabriel, j’espère revendiquer cet héritage : le rythme feuilletonesque, les complots et les énigmes, les ruelles et les palais, l’alliance du romanesque et du documentaire.
Un mot des chevaux, présents dans toutes les pages ou presque de ce livre. On vous croirait cavalier…
J’ai un profond amour pour les chevaux et pour l’équitation – et, plus encore, pour l’histoire qui nous relie à eux. Depuis des millénaires, le cheval accompagne nos guerres et nos moissons, nos voyages et nos fêtes; il a façonné nos paysages comme nos imaginaires. Vivre aujourd’hui avec un cheval m’apporte une forme de sérénité : chaque séance de travail est une conversation silencieuse où l’animal, comme un miroir sans complaisance, reflète nos forces, nos hésitations, notre cohérence… Dans ce roman, j’ai voulu rendre justice à ce compagnonnage en donnant une place centrale aux chevaux, portés par un décor qui s’y prête magnifiquement: les écuries de Versailles. Elles n’étaient pas de simples dépendances: elles formaient un véritable cœur battant du royaume. La Grande et la Petite Écurie, les écuries de la Reine, toutes abritaient chevaux, attelages, pages et écuyers; on y cultivait une équitation de haute école qui devait autant à l’élégance qu’à la rigueur. C’est là qu’une certaine idée française de l’art équestre s’est affirmée.
Le Fantôme de Versailles est aussi une plongée fascinante dans les arcanes du château de Versailles. Comment vous êtes-vous documenté ?
Je me suis documenté en lisant énormément, des textes de l’époque comme des études récentes, en me rendant sur place, et en travaillant aux archives du Château de Versailles, que Karine Mc Grath a eu la gentillesse de m’ouvrir. Versailles est une institution unique : tout y a laissé des traces. On y trouve des inventaires, des plans, des registres de services, des correspondances, des comptes et des ordonnances, sans oublier les livrets des écuries, les états de dépenses, les listes de livrées, les journaux de cour, les mémoires et une iconographie foisonnante. Cette masse documentaire permet de recouper les détails – un itinéraire, un horaire, un passage secret – et de restituer la vie du lieu avec précision. Karine, cheffe du service des archives, est elle-même cavalière: cela crée forcément des affinités, et son regard a été précieux pour éclairer mes recherches.
L’écrivain que vous êtes apparaît de plus en plus éclectique. L’auteur des enquêtes de Gabriel Joly ou des Disparus de Blackmore est le même qui écrit Nous rêvions juste de liberté et Pour ne rien regretter – romans sur la nostalgie, les désillusions, les derniers rêves. Si vraiment vous dites adieu à Gabriel Joly, quelle nouvelle aventure réservez-vous à vos lecteurs ?
Je me suis toujours gardé de m’enfermer dans un seul genre : chaque roman répond à une autre ambition, à une autre envie. Le prochain nous emmènera en 1880, du nord de la France jusqu’au Montana, sur les traces bien réelles de Pierre Wibaux, ce Français qui a tout quitté pour tenter la grande aventure de l’Ouest. Ce sera pour moi l’occasion de dire mon amour de l’Amérique, mais aussi les immenses déceptions qu’elle inspire parfois, hier comme aujourd’hui : le sort terrible des peuples amérindiens, la fin de l’open range emportée par les barbelés, le rail et la spéculation… Ce livre est aussi un hommage aux grands espaces et une élégie pour ce qu’ils sont souvent devenus, fragmentés, industrialisés, abîmés par une course au progrès frénétique. J’aimerais faire sentir la beauté de ces terres et la tristesse de leur transformation. Et puis rappeler que l’histoire des États-Unis est une histoire d’immigrés, notamment… français !
lire toute l’interview
la presse en parle
« Avec son roman Le Fantôme de Versailles Henri Lœvenbruck nous plonge au cœur de la grande histoire avec les compagnons de Gabriel Joly, jeune journaliste d’investigation et héros des trois précédents romans. »
Véronique Beaugrand, Le Parisien
« Henri Lœvenbruck régale le public avec un Cluedo géant au cœur de Versailles (…) Avec minutie, Henri Lœvenbruck reconstitue l’atmosphère de la Cour et fait entrer le lecteur dans les arcanes du pouvoir. »
Frédéric Rapilly, Télé 7 jours
« Fans des trois mousquetaires, de Fanfan la Tulipe ou encore de Scaramouche, le nouveau roman d’aventures d’Henri Lœvenbruck est pour vous ! Il y a du panache, des personnages hors du commun et de l’amour, le tout baignant dans la grande histoire. »
Jean-Marc Rapaz, Générations
« Cet ultime volet d’une quadrilogie dédiée aux enquêtes de Gabriel joly nous plonge avec talent au cœur de la Révolution française, lors de cette fameuse journée du 5 octobre. Notre enquêteur connaît une trajectoire particulièrement mouvementée, mais ne se départ pas des nobles idéaux qui l’habitent. Le romancier déploie dans son récit un suspense intense, dans un style soigné très agréable à lire. »
Marie-Lorraine Roussel, Famille Chrétienne
« Pour le quatrième et dernier tome de la sage, Henri Lœvenbruck nous offre une enquête passionnante et haletante, riche en rebondissements. »
Amélie Descroix, France dimanche